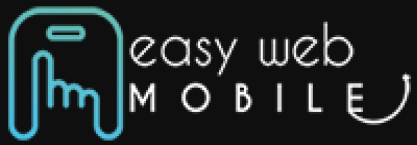Il y a 1601 actualités sur Angelets de la Terra
Santa Coloma de Tuïr adopte la motion pour la reconnaissance officielle du catalan en Europe
(25-01-2026)
Le 6 janvier 2026, la mairie de Santa Coloma de Tuïr (Sainte-Colombe-de-la-Commanderie) a approuvé la motion présentée par les Angelets de la Terra pour soutenir la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Santa Coloma de Tuïr est une commune des Pyrénées-Orientales, située dans la région historique du Conflent, à environ 10 km de Perpignan. Elle compte environ 146 habitants et s’étend sur un territoire de plaines et de collines, avec une forte présence de zones agricoles et viticoles. La commune conserve un patrimoine historique et architectural notable, avec son église paroissiale et des maisons anciennes typiques de la région.
Contenu de la motionLa décision approuvée par la mairie soutient la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne. Elle affirme l’engagement de la commune en faveur de la diversité linguistique en France et en Europe, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Le texte rappelle que le catalan compte plus de 10 millions de locuteurs en Europe, qu’il est langue officielle en Andorre, co-officielle dans plusieurs territoires de l’État espagnol et qu’il bénéficie de la protection de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il souligne également que la demande officielle de reconnaissance du catalan auprès de l’Union européenne par le gouvernement espagnol renforcerait la diversité culturelle européenne et la dignité des locuteurs catalans.
L’association Angelets de la Terra invite toutes les communes à rejoindre cette initiative, qui permet à la Catalogne Nord de se faire entendre dans un débat européen crucial pour l’avenir de la langue. Les mairies peuvent contacter l’association pour obtenir le modèle de motion et participer aux conférences de presse prévues, en présence d’élus et de personnalités culturelles engagées dans la campagne.
Avec cette approbation, Santa Coloma de Tuïr (Sainte-Colombe-de-la-Commanderie) s’ajoute au ensemble des communes qui travaillent pour la défense de la langue catalane commune et pour le renforcement des liens entre tous les territoires du pays dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Oleta adopte à l'unanimité la motion pour la reconnaissance officielle du catalan en Europe
à
- Oleta CONFLENT
(25-01-2026)
Le 12 décembre 2025, la mairie de Oleta a approuvé à l’unanimité la motion présentée par les Angelets de la Terra pour soutenir la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Oleta est une petite commune située dans le Conflent, dans les Pyrénées‑Orientales. Elle compte environ 384 habitants et s’étend sur un territoire de montagnes et de vallées typiques de la région. Le village conserve un patrimoine historique modeste mais caractéristique, avec son église paroissiale et des constructions traditionnelles en pierre, témoins de la vie rurale catalane. Sa situation isolée au cœur des montagnes en fait un lieu particulièrement attaché à la préservation de ses traditions et de la langue catalane.
Contenu de la motionLa décision approuvée par la mairie d’Oleta soutient la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne. Elle affirme l’engagement de la commune en faveur de la diversité linguistique en France et en Europe, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Le texte rappelle que le catalan compte plus de 10 millions de locuteurs en Europe, qu’il est langue officielle en Andorre, co-officielle dans plusieurs territoires de l’État espagnol et qu’il bénéficie de la protection de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il souligne également que la demande officielle de reconnaissance du catalan auprès de l’Union européenne par le gouvernement espagnol renforcerait la diversité culturelle européenne et la dignité des locuteurs catalans.
L’association Angelets de la Terra invite toutes les communes à rejoindre cette initiative, qui permet à la Catalogne Nord de se faire entendre dans un débat européen crucial pour l’avenir de la langue. Les mairies peuvent contacter l’association pour obtenir le modèle de motion et participer aux conférences de presse prévues, en présence d’élus et de personnalités culturelles engagées dans la campagne.
Avec cette approbation, Oleta s’ajoute au ensemble des communes qui travaillent pour la défense de la langue catalane commune et pour le renforcement des liens entre tous les territoires du pays dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
La Guingueta d’Ix s'engage à voter la motion pour soutenir la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’UE
à
- Guingueta d'Ix (La) - ALTA CERDANYA
(25-01-2026)
La mairie de La Guingueta d’Ix (Bourg‑Madame) s'engage à voter la motion présentée par les Angelets de la Terra pour soutenir la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
La Guingueta d’Ix, connue officiellement en français sous le nom de Bourg‑Madame, est une commune du département des Pyrénées‑Orientales, en région Occitanie, située en Alta Cerdanya à la frontière avec l’Espagne. Elle compte environ 1 200 habitants et s’étend sur un territoire d’environ 7,9 km², à une altitude moyenne d’environ 1 140 m ; ses habitants sont appelés les Guinguettois ou Guinguettoises.
La localité a pris naissance comme hameau sur le territoire de l’ancien village d’Ix (Hix en français) à la suite du tracé de la frontière entre la France et l’Espagne après les traités des Pyrénées au XVIIᵉ siècle. Ce hameau, appelé La Guingueta d’Ix, s’est développé grâce au commerce transfrontalier et à l’afflux de populations, jusqu’à devenir plus important que le village d’origine. En 1815, il fut rebaptisé Bourg‑Madame en l’honneur de la duchesse d’Angoulême, intitulée Madame Royale.
La commune possède un patrimoine naturel et culturel riche, avec des paysages de haute plaine cerdane et des édifices historiques tels que l’église romane d’Hix et d’anciennes constructions rurales liées à l’histoire de la région. Sa position frontalière, bordée d’une part par Puigcerdà (Espagne) et d’autre part par l’enclave de Llivia (Espagne), lui confère une identité particulière au cœur de la Cerdagne franco‑espagnole.
Contenu de la motionLa décision approuvée soutient la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne. Elle affirme l’engagement de la commune en faveur de la diversité linguistique en France et en Europe, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ». L’année 2025 est présentée comme une étape décisive pour la défense institutionnelle du catalan en Catalogne Nord. Plusieurs communes ont déjà rejoint cette initiative, et d’autres disposent encore d’un délai pour le faire.
Le texte rappelle que le catalan compte plus de 10 millions de locuteurs en Europe, qu’il est langue officielle en Andorre, co‑officielle dans plusieurs territoires de l’État espagnol et qu’il bénéficie de la protection de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il souligne aussi que la demande officielle de reconnaissance du catalan auprès de l’Union européenne par le gouvernement espagnol renforcerait la diversité culturelle européenne et la dignité des locuteurs catalans.
L’association Angelets de la Terra invite toutes les communes à rejoindre cette initiative, qui permet à la Catalogne Nord de se faire entendre dans un débat européen crucial pour l’avenir de la langue. Les mairies peuvent contacter l’association pour obtenir le modèle de motion et participer aux conférences de presse prévues, en présence d’élus et de personnalités culturelles engagées dans la campagne.
Santa Maria de Besora affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 19 janvier 2026, la mairie de Santa Maria de Besora a approuvé la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Santa Maria de Besora est une petite commune de la comarque d’Osona, dans la province de Barcelone, située dans la région du Bisaura, au nord de la comarque et à la limite avec le Ripollès. Avec environ 160 habitants répartis sur près de 25 km², elle est l’un des municipes les moins peuplés d’Osona. Le village est perché à une altitude d’environ 866 m et s’est développé autour de son castell médiéval et de l’église romane de Santa Maria, éléments historiques qui dominent encore aujourd’hui le paysage local. Entouré de forêts, de prairies et de falaises, le territoire municipal est caractérisé par une économie essentiellement rurale fondée sur l’agriculture de secano et la ramenerie, avec quelques activités liées à la forêt et aux produits locaux. Santa Maria de Besora conserve un cadre naturel et patrimonial très marqué, avec des vestiges historiques et des itinéraires de randonnée offrant une immersion dans l’environnement naturel du Bisaura.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Sant Julià de Vilatorta affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 20 janvier 2026, la mairie de Sant Julià de Vilatorta a approuvé la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Sant Julià de Vilatorta est une commune de la comarque d’Osona, dans la province de Barcelone, située à environ 5 km à l’est de Vic, la capitale comarcale. Avec environ 3 300 habitants (estimation récente) répartis sur une superficie d’environ 16 km², elle occupe un lieu de transition entre la Plana de Vic et les massifs boisés des Guilleries, combinant terrains agricoles, zones forestières et collines. Le territoire municipal comprend aussi l’entité de Vilalleons, fusionnée administrativement depuis 1945 mais avec une identité propre. Le village est caractérisé par sa richesse patrimoniale, comme l’ancienne fontaine Noguera ou les Set Fonts et les ruines du casal fortifié des Bellpuig, ainsi que par une architecture moderniste et noucentiste intégrée à son bâti traditionnel. La vie locale est animée par un tissu associatif et culturel actif, des traditions locales et un lien fort avec l’histoire rurale de la région.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Salàs de Pallars affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 30 septembre 2025, la mairie de Salàs de Pallars a approuvé à l’unanimité la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : « Une langue sans frontières ».
Salàs de Pallars est une petite commune située dans la comarca du Pallars Jussà, dans la province de Lleida, nichée dans la haute vallée du Pre‑Pirineu entre La Pobla de Segur et Tremp, à environ 573 mètres d’altitude. Avec environ 350 habitants répartis sur un territoire rural d’environ 20 km², elle se distingue par son noyau fortifié historique (vila closa) autour de rues et d’une place porticée, ainsi que par des rues liées à l’activité traditionnelle des foires agricoles et d’élevage qui ont façonné son urbanisme au fil des siècles. La vie locale s’articule autour du secteur des services, de l’agriculture et de l’élevage, et la commune conserve un patrimoine traditionnel marqué par ses anciennes structures médiévales, son cadre naturel et son histoire rurale singulière dans le contexte pallaresenc.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Montferri affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 7 octobre 2025, la mairie de Montferri a approuvé la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : "Une langue sans frontières".
Montferri est une commune de la province de Tarragone, située dans la comarque de l’Alt Camp, au sud‑est de la région, à la limite avec la comarque du Tarragonès, sur les rives du riu Gaià. Elle compte environ 390 habitants (estimations récentes) et s’étend sur près de 19 km² dans un paysage rural marqué par les cultures de secano, notamment la vigne, ainsi que par des collines et vestiges historiques. Le terme municipal comprend aussi l’agglomération de Vilardida. Montferri conserve un patrimoine architectural intéressant, avec notamment l’église paroissiale de Sant Bartomeu, des restes de tours médiévales comme la Torre del Moro, ainsi que le sanctuaire de la Mare de Déu de Montserrat, une œuvre moderniste conçue par l’architecte Josep Maria Jujol, disciple de Gaudí.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Montesquiu affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 25 novembre 2025, la mairie de Montesquiu a approuvé à l’unanimité la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : "Une langue sans frontières".
Montesquiu est une commune de la province de Barcelone, située dans la comarque d’Osona, au bord de la rivière Ter, à la transition entre la plaine de Vic et les zones de montagne pré‑pyrénéennes. Avec environ 1 095 habitants selon les derniers registres (estimation 2025), elle forme un village à la fois rural et historiquement actif dans le développement industriel lié autrefois à l’eau du Ter. Son ancien château médiéval, documenté dès le XIIIᵉ siècle, domine encore aujourd’hui le paysage local et constitue un symbole du patrimoine du territoire, intégré avec le parc du Castell de Montesquiu qui l’entoure. Montesquiu conserve une identité culturelle riche, avec des traditions locales, des fêtes populaires et un tissu social marqué par son histoire et son environnement naturel.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Massalcoreig affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 8 septembre 2025, la mairie de Massalcoreig a approuvé la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : "Une langue sans frontières".
Massalcoreig est une commune de la province de Lleida, située dans la comarque du Segrià, au sud‑ouest du territoire, à la confluence des rivières Cinca et Segre. Avec environ 590 habitants à la fin de 2025, elle forme un petit village rural caractéristique de cette partie de la Catalogne, entouré de terres agricoles fertiles irriguées par le canal d’Aragó i Catalunya. La localité est traversée par une économie essentiellement liée à l’agriculture et à l’irrigation, et elle conserve un tissu social et culturel marqué par ses traditions territoriales. Massalcoreig possède également un patrimoine local significatif, notamment dans son organisation spatiale autour de la place de l’Église et dans l’influence de son histoire rurale.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Guardiola de Berguedà affirme son soutien au catalan et à la Catalogne Nord en approuvant la motion des Angelets de la Terra
(25-01-2026)
Le 23 janvier 2026, la mairie de Guardiola de Berguedà a approuvé la motion présentée par les Angelets de la Terra pour renforcer la défense de la langue catalane commune et consolider les liens institutionnels entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, dans le cadre de la campagne des Angelets de la Terra : "Une langue sans frontières".
Guardiola de Berguedà est une commune du Berguedà, d’environ 950 habitants, située dans la haute vallée du Llobregat. Elle est entourée de forêts, de rivières et de reliefs pré‑pyrénéens caractéristiques de la région. Le village s’est historiquement développé autour de la route reliant l’Alt Berguedà au Ripollès et à la Cerdagne, ce qui en a fait un point de passage entre plusieurs vallées. Son patrimoine est étroitement lié au monastère de Sant Llorenç prop de Bagà, un ensemble médiéval majeur du territoire. Le village conserve également un tissu local dynamique, associé aux activités de montagne, à un patrimoine rural dispersé et à une forte présence des traditions catalanes dans la vie associative et culturelle.
Contenu de la motion
Soutien aux municipalités de la Catalogne Nord pour que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l’Union européenne.
Reconnaissance de la solidarité de la Catalogne Nord envers la population du sud lors des événements de 2017.
Engagement de coopération entre municipalités du nord et du sud afin de consolider le catalan comme outil partagé de cohésion culturelle, sociale et institutionnelle.
Soutien aux mairies nord‑catalanes qui réclament le droit d’utiliser le catalan lors des séances des conseils municipaux.
Resultat de la recherche
: {{ itemarecherchesauvegarde }}


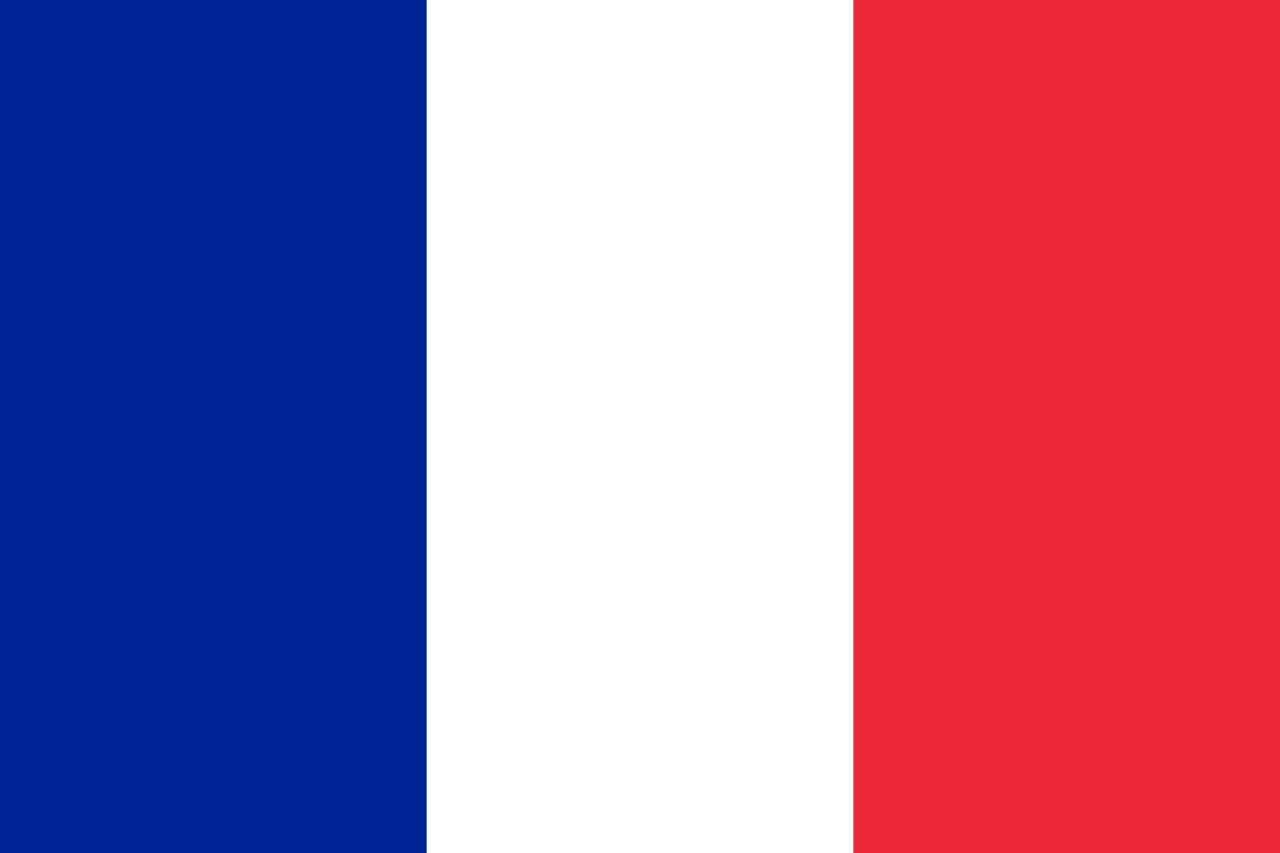 FR
FR
 CAT
CAT